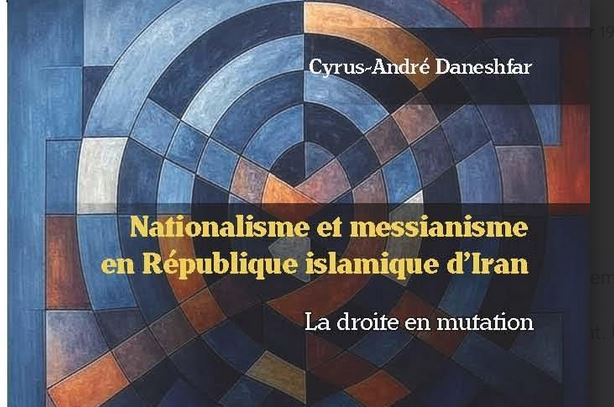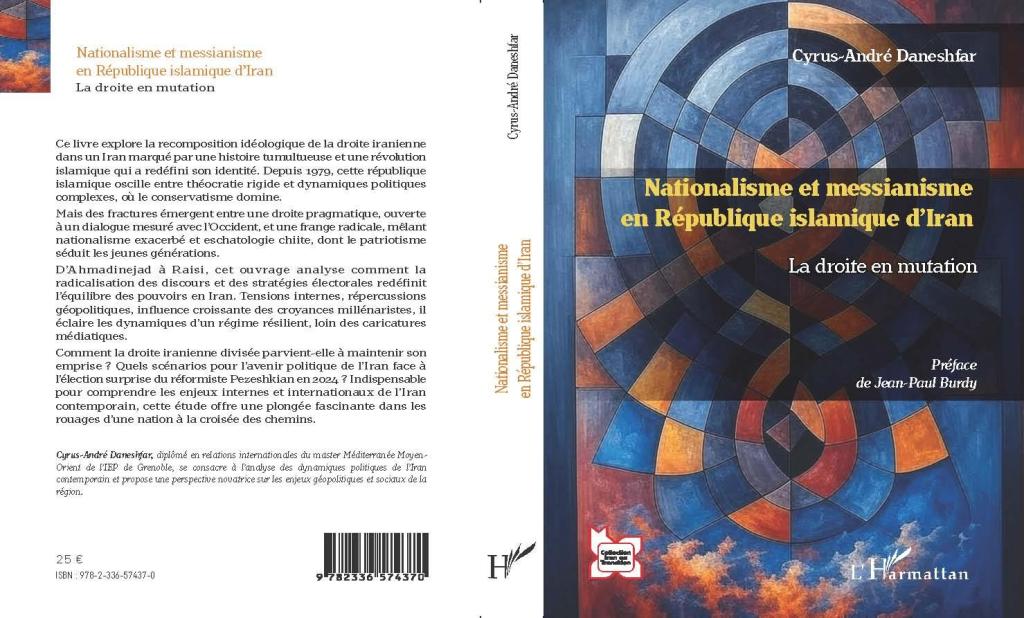
Cyrus-André Daneshfar, étudiant diplômé du master « Méditerranée-Moyen-Orient » de l’Institut d’études politiques de Grenoble s’est intéressé, dans un mémoire de recherche sur la République islamique, aux dynamiques, aux tensions aux lignes de force du « camp conservateur », qualifié de « droite iranienne ». Nous avons préfacé (avant la « Guerre de 12 jours » de juin 2025) la publication de ce travail aux Editions L’Harmattan, dans la collection « L’Iran en transition », dirigée par Ata Ayati.
Préface :
« Les catégories d’analyse appliquées à la politique intérieure iranienne restent en général assez sommaires, qu’il s’agisse d’en définir les principaux courants, ou les phases successives. Globalement, elles distinguent d’un côté les « conservateurs » et « ultra-conservateurs », de l’autre les « réformateurs ». Au-delà de la figure idéologiquement fondatrice de l’Imam Khomeyni, ces courants seraient incarnés par les présidents de la République islamique successifs: les « conservateurs », plus ou moins radicaux, Ali Khamenei, Mahmoud Ahmadinejad, Ebrahim Raïssi ; et les « réformateurs » modérés – Ali Rafsandjani, Massoud Pezeshkian ; ou « progressistes » – Mohammad Khatami, Hassan Rohani. Ces derniers, à partir du moment où ils ont été autorisés à concourir à la présidence, étant souvent bien élus, mais rapidement empêchés d’impulser la moindre réforme. D’où, après la guerre Irak-Iran, des cycles successifs « d’ouverture » et d’espoirs – toujours déçus- de démocratisation, suivis de périodes de fermeture répressive.
En l’absence de partis politiques formellement autorisés et institutionnalisés, des courants idéologiques et politiques existent néanmoins bel et bien, et deviennent épisodiquement lisibles lors de campagnes électorales certes brèves (et verrouillées par la sélection en amont des candidats : les « réformateurs » ont été de facto interdits de présidentielle et de législatives de 2020 à 2024), mais parfois intenses et disputées. Cyrus-André Daneshfar, étudiant diplômé du master « Méditerranée-Moyen-Orient » de l’Institut d’études politiques de Grenoble, s’est intéressé aux dynamiques et aux tensions politiques et intellectuelles qui structurent depuis quarante-six ans le régime islamique. Plus précisément, il a cherché à décortiquer les lignes de force du « camp conservateur », qualifié de « droite iranienne ». Relevant que les observateurs concentrent leur attention sur le courant réformiste, partisan d’une ouverture vers l’Occident, l’auteur entend « tenter de combler le manque de littérature académique, surtout dans le monde francophone, en matière d’anthropologie de la droite iranienne. » Ce courant structure la vie politique sur la longue durée, les périodes « réformatrices » (que l’on pourra difficilement qualifier de « gauche iranienne », celle-ci ayant été d’abord instrumentalisée, puis éradiquée dès 1981) apparaissant comme des parenthèses autorisées par le régime – par exemple pour permettre la négociation et l’amorce de mise en œuvre de l’accord sur le nucléaire de 2015, avec Hassan Rohani ; et pour relancer une renégociation de cet accord dès 2023, et en 2025, avec l’élection inattendue de Massoud Pezeshkian).
Daneshfar montre que le courant conservateur est parcouru de tensions sur la plupart des sujets : le rapport à la théocratie (la doctrine du velayat-e faqih, le choix du Guide suprême) ; les questions sociétales (l’obligation du port du hijab) ; l’ouverture diplomatique à l’Occident (maintenir la radicalité anti-impérialiste des origines, ou adopter un pragmatisme à visées économiques), etc. L’auteur distingue, dès lors, deux sous-groupes principaux : les conservateurs « traditionnels/pragmatiques », qui formeraient un « centre-droit » et, d’autre part, les conservateurs « radicaux », tenants intangibles des principes fondateurs de la République islamique, instrumentalisant parfois l’ésotérisme chiite en une forme de de « patriotisme eschatologique » (lisible en particulier au sein des Gardiens de la Révolution). Cette classification est établie pour la commodité de l’analyse nous prévient-il cependant, car selon les sujets et selon les configurations électorales, ces sous-groupes et les personnalités qui les incarnent peuvent faire preuve d’accommodements bien compris, qui se traduisent par des inflexions en politique extérieure (afficher l’anti-américanisme principiel, et négocier avec Washington) ou des alliances et des coalitions électorales d’opportunité. Daneshfar incite donc observateurs et acteurs des relations internationales à être attentifs aux personnalités de ce courant structurant de la vie politique, car elles ne sont pas sans influence sur la possibilité de négocier ou pas des compromis avec le régime iranien.
Au terme de son étude, Daneshfar conclut à la solidité et à la résilience du régime né en 1979, critiquant la surestimation chez les observateurs des ferments d’un possible effondrement, en particulier lors de chaque crise secouant la société iranienne, depuis la contestation électorale de 2009 au mouvement « Femme-Vie-Liberté » depuis 2022. Il estime que ces observateurs sont influencés à l’excès par les groupes iraniens d’opposition basés à l’extérieur du pays (et donc coupés de la société iranienne réelle), qui mènent un incessant lobbying auprès des médias et des gouvernements occidentaux, et biaisent ainsi la perception du régime de Téhéran. On peut ne pas être en total accord avec cette évaluation de l’auteur. L’histoire nous offre une liste fort longue de régimes (et d’autocrates) supposés d’une solidité à toute épreuve, et qui se sont effondrés parfois au terme d’une longue agonie, parfois de manière apparemment soudaine : sapés de l’intérieur toujours, sous les coups de boutoirs d’interventions extérieures à l’occasion. Le Moyen-Orient contemporain nous en offre maints exemples, de l’Iran en 1979 à l’Irak en 2003, de la Tunisie, de la Libye et de l’Egypte en 2011 à la Syrie en 2024. L’auteur surprend donc quelque peu quand il écrit que « l’emprise institutionnelle du régime à l’intérieur du pays et son influence sur la scène régionale n’ont cessé de croître au cours des quarante-six dernières années.» A l’intérieur, Daneshfar nous paraît là surestimer et la solidité de la base sociale du régime, et l’apathie d’une jeunesse désabusée, et la démobilisation de l’électorat réformiste. Quant au volet régional, l’année 2024 est une succession d’échecs cuisants pour Téhéran, de Gaza au Hezbollah, des frappes israéliennes à l’effondrement du régime Assad en Syrie. On se gardera donc de préjuger de la résilience à long terme du régime de la République islamique dans sa forme actuelle… »
Jean-Paul BURDY, historien, enseignant-chercheur associé à Sciences Po Grenoble